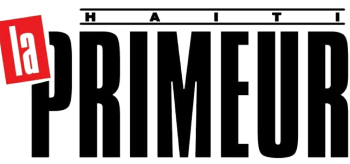La récente visite officielle du Premier ministre haïtien Alix Didier Fils-Aimé aux États-Unis semble avoir déclenché une nouvelle dynamique autour du dossier haïtien à Washington. Sa rencontre, le 15 juillet, avec le sénateur Raphael Warnock (D-GA), a donné un élan politique qui, dix jours plus tard, se matérialise par des initiatives parlementaires inédites en faveur d’Haïti.
Un plaidoyer ferme au Sénat américain
Durant son séjour, le Premier ministre a rencontré plusieurs figures du Congrès et de l’administration américaine, mais c’est son échange avec le sénateur Raphael Warnock qui a marqué un tournant.
Cette rencontre, tenue au Sénat, a porté sur trois enjeux majeurs : le renforcement de la sécurité et de l’État de droit, l’organisation d’élections libres et inclusives, et la pérennité de la loi HOPE/HELP, vitale pour l’économie haïtienne.
D’après le communiqué officiel, Alix Didier Fils-Aimé a rappelé avec insistance la nécessité de créer les conditions d’une stabilité institutionnelle durable, affirmant que sans sécurité ni institutions solides, aucune relance économique n’est possible.
Il a également mis en avant l’impact crucial de la loi HOPE/HELP, qui permet à Haïti d’exporter des produits textiles vers les États-Unis dans des conditions préférentielles, soutenant des milliers d’emplois et offrant une bouffée d’oxygène à l’industrie locale.
Le chef du gouvernement a exhorté le Congrès américain à maintenir cet instrument :« La reconduction de HOPE/HELP est essentielle pour préserver les emplois et contribuer à la lutte contre la pauvreté. Elle constitue un pilier stratégique de la coopération économique entre nos deux nations », avait-il plaidé.
Une lettre forte de huit sénateurs à Washington
Dix jours après cette rencontre, un signe concret montre que ce plaidoyer n’a pas été vain. Un groupe de sénateurs américains – parmi lesquels Raphael Warnock, Edward J. Markey, Chris Van Hollen, Elizabeth Warren, Bernie Sanders, Alex Padilla, Adam Schiff, Peter Welch et Cory Booker – a adressé une lettre officielle au Département d’État et au Département de la Sécurité intérieure, demandant des clarifications sur la politique américaine en Haïti.
Cette correspondance, envoyée le 24 juillet, cible plusieurs sujets sensibles :
L’utilisation par le gouvernement haïtien de sociétés militaires privées américaines, en particulier une entreprise dirigée par Erik Prince, ancien patron de Blackwater.
Les contradictions entre l’aide sécuritaire américaine et la décision récente de mettre fin au TPS (Temporary Protected Status) pour les Haïtiens, ainsi que l’inclusion du pays dans une interdiction de voyager.
Les risques que font peser ces interventions privées sur la Mission multinationale de soutien à la sécurité (MSS) soutenue par l’ONU et par les États-Unis.
La lettre souligne que ces opérations privées peuvent affaiblir les efforts multilatéraux, et pose des questions précises sur la légalité de ces interventions et sur leur conformité avec les obligations légales américaines.
Les sénateurs demandent des réponses écrites avant le 15 août sur six points clés, notamment sur l’octroi éventuel de licences d’exportation pour ces activités militaires, leur compatibilité avec les droits humains et les procédures de vérification appliquées aux unités de la Police nationale haïtienne recevant un soutien américain.
« Ces actions sont incohérentes : d’un côté, on affirme qu’Haïti est trop dangereux pour y voyager, et de l’autre, on dit que le pays est assez sûr pour y renvoyer ses ressortissants », soulignent les signataires.
Un impact politique perceptible pour le dossier haïtien
Pour de nombreux observateurs, la mobilisation sénatoriale qui suit la mission d’Alix Didier Fils-Aimé illustre un changement d’approche : Haïti revient au centre des préoccupations du Congrès après plusieurs mois d’inertie.
Les sénateurs insistent notamment sur le fait que les actions unilatérales d’acteurs privés comme Blackwater pourraient fragiliser la mission multilatérale MSS, déjà sous-dotée en moyens et en effectifs, et accroître le chaos dans la capitale haïtienne.
La lettre met également en lumière la contradiction de la politique migratoire américaine : mettre fin au TPS, programme qui protège les Haïtiens aux États-Unis, tout en reconnaissant que la situation sécuritaire dans leur pays est extrêmement dangereuse.
Selon une source diplomatique à Washington, ce regain d’attention est « un signal positif pour le plaidoyer mené par le gouvernement haïtien. » La dynamique lancée pourrait ouvrir des discussions plus franches sur la prolongation du TPS, sur le contrôle des interventions armées privées et sur le soutien logistique de la MSS.
En Haïti, ce mouvement est accueilli comme une victoire diplomatique partielle pour le Premier ministre. Il reste toutefois à voir si cette prise de conscience au Congrès se traduira rapidement en mesures concrètes pour soutenir la sécurité et la stabilité du pays.
Une diplomatie active face à une crise profonde
La visite d’Alix Didier Fils-Aimé à Washington marque une étape importante dans la stratégie de son gouvernement.
Dans un contexte où 1,3 million d’Haïtiens sont déplacés, la moitié étant des enfants, et où 42 % des infrastructures de santé de Port-au-Prince ne fonctionnent plus, l’enjeu est de taille.
La prochaine étape consistera à transformer cet élan politique en actions concrètes : maintien du TPS, renouvellement de HOPE/HELP, appui accru à la Police nationale d’Haïti et encadrement strict des acteurs militaires privés.
Les signaux venus du Sénat américain laissent penser que les points commencent enfin à se déplacer en faveur des Haïtiens, mais le chemin reste long pour passer des intentions aux résultats.