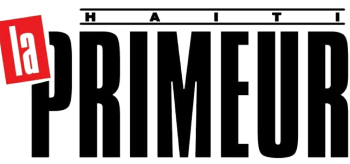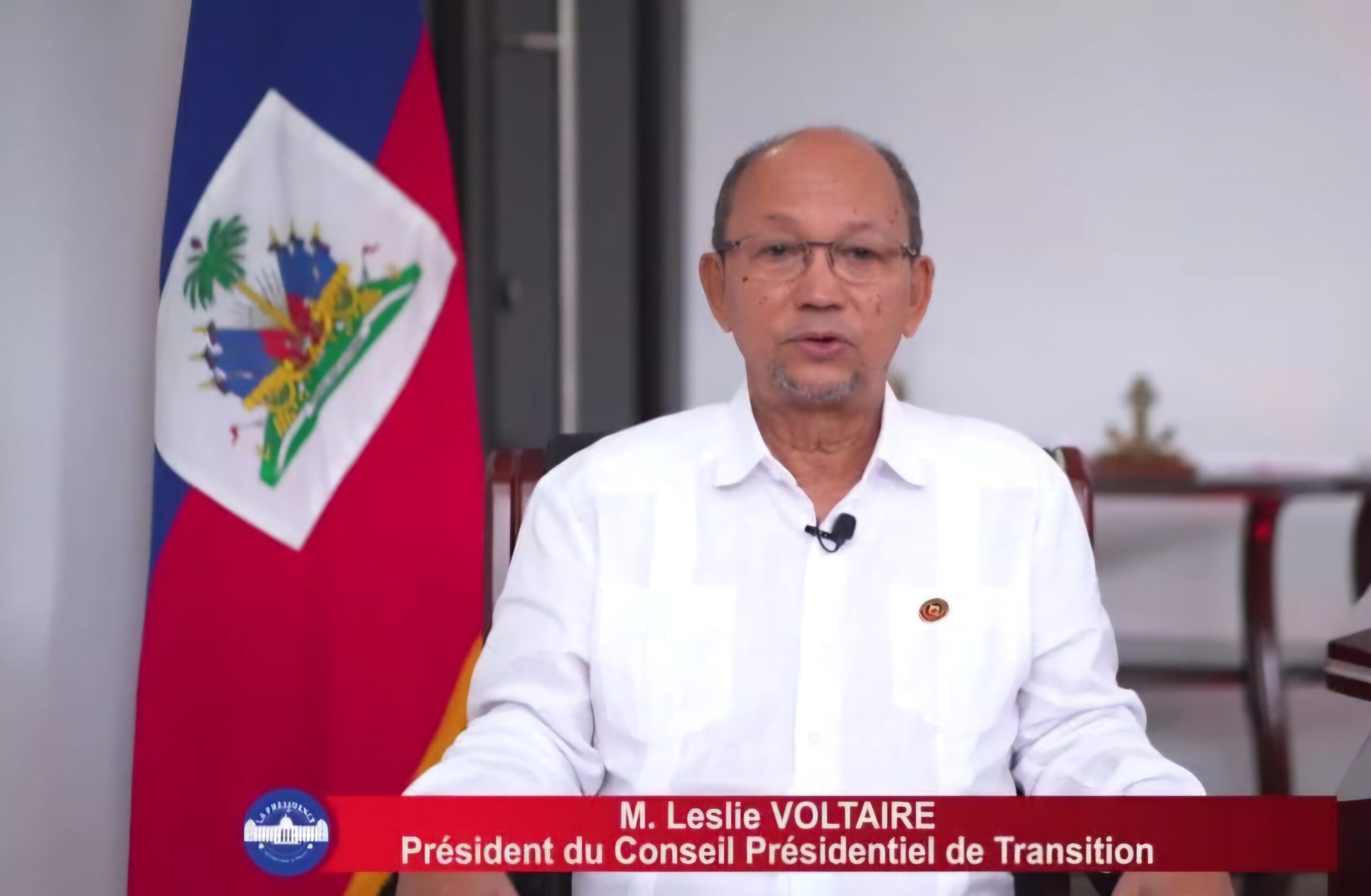Port-au-Prince, 24 Avril 2025 — Haïti traverse l’une des périodes les plus sombres de son histoire contemporaine. Dans les rues de Port-au-Prince et au-delà, le chaos sécuritaire ne laisse aucun répit à une population meurtrie, prise en étau entre violence, insécurité, corruption et impunité. Au centre de cette crise, quatre hommes incarnent aujourd’hui la faillite d’un système : Me Patrick Pélissier, ministre de la Justice et de la Sécurité publique ; Paul Antoine Bien-Aimé, ministre de l’Intérieur et des Collectivités Territoriales ; Mario Andrésol, désormais secrétaire d’État à la Sécurité publique ; et Normil Rameau, directeur général de la Police nationale d’Haïti (PNH). Il est temps pour ces figures de tirer leur révérence. Parce qu’à un moment critique, il faut que des têtes tombent pour que la République puisse respirer.
Me Patrick Pélissier : Ministre de la Justice, au cœur d’une machine judiciaire désespérée
Me Patrick Pélissier est arrivé au ministère de la Justice avec la promesse de redonner vigueur à une institution fragilisée par des années de dépendance politique, de clientélisme, et de dysfonctionnement. Pourtant, depuis sa prise de fonction, le ministère a sombré davantage dans l’inaction. Les audiences se font rares, les juges opèrent dans la peur constante de représailles des gangs, et les procureurs sont souvent sans moyens réels d’agir. Plus grave encore, de nombreuses affaires criminelles d’envergure n’ont jamais été instruites.
Ce qui reste des prisons haïtiennes débordent de détenus en attente de jugement, dans une violation manifeste des droits humains. Le ministre Pélissier n’a jamais publié un plan de réforme clair, ni lancé d’initiatives pour moderniser les tribunaux ou protéger les magistrats. Pire encore, les tribunaux eux-mêmes sont désormais relocalisés, fuyant les territoires contrôlés par les gangs armés. Les commissariats de police tombent un à un sous leur emprise, et plusieurs centres de détention ont été attaqués ou vidés. Le dernier exemple en date est celui de la prison de Mirebalais, entièrement vidée par les gangs 400 Mawozo et Jeff Gwo Lwa. Ces derniers ont pris le contrôle total de la ville, allant jusqu’à rebaptiser Radio Panik FM sous le nom de Taliban FM.
Pendant ce temps, les dossiers de crimes politiques, d’enlèvements, de corruption et de massacres collectifs stagnent, nourrissant une impunité généralisée. Le ministre Pélissier n’incarne plus qu’un système judiciaire à bout de souffle. Sa démission n’est plus seulement une option ; elle est une nécessité nationale.
Paul Antoine Bien-Aimé : Un ministre de l’Intérieur hors du temps
Déjà ministre sous d’anciennes administrations, Paul Antoine Bien-Aimé semble incarner le retour d’une vieille garde politique dont les méthodes ne répondent plus aux besoins d’un pays en feu. Responsable de la coordination des collectivités territoriales, il est aussi garant de l’ordre public en lien avec les autorités locales. Il revient aujourd’hui aux commandes du ministère de l’Intérieur et des Collectivités Territoriales, son retour n’a rien d’une renaissance administrative. Là où l’on attendait un gestionnaire rigoureux, un stratège du territoire, on a trouvé un gestionnaire invisible.
Les structures locales de l’État sont à l’abandon. Les maires, les CASEC et les ASEC sont laissés à eux-mêmes. L’administration territoriale, censée être le bras exécutif de l’État au niveau communal, est dépourvue de ressources, d’encadrement et de directives stratégiques. En pleine crise sécuritaire, alors que les territoires ruraux comme urbains sombrent dans la loi des gangs, le ministère de l’Intérieur s’illustre par son absence totale.
Et pourtant, Paul Antoine Bien-Aimé conserve tous les privilèges liés à sa fonction. Résidences, gardes du corps, budgets de fonctionnement, tout cela reste intact, alors même que les populations locales n’ont plus accès à la moindre protection de l’État. Il garde un silence de cimetière face à la décomposition de l’administration territoriale. Ce silence assourdissant est devenu une trahison. Il doit tirer sa révérence.
Mario Andrésol : Secrétaire d’État à la Sécurité publique, fantôme dans la tempête
Mario Andrésol, autrefois directeur général de la Police nationale d’Haïti entre 2005 et 2012, est aujourd’hui le secrétaire d’État à la Sécurité publique. Ce retour aux affaires aurait pu être une opportunité pour mobiliser son expérience, mais il s’est avéré un fiasco total.
Dans un contexte de guerre urbaine, Andrésol s’est montré totalement absent. Ce poste, censé être le cœur de la stratégie opérationnelle contre les gangs, est aujourd’hui sans ligne directrice, sans coordination visible, et sans résultats. Aucun plan d’action, aucun protocole de riposte, aucun message à la nation. Son passage à ce poste stratégique est marqué par l’invisibilité.
Les massacres de civils se multiplient, les exécutions sommaires deviennent monnaie courante, et les zones de non-droit s’étendent. Pourtant, le Secrétaire d’État reste figé. Ce mutisme et cette paralysie mettent en péril l’ensemble de l’appareil sécuritaire de l’État. Il ne s’agit plus d’une simple absence d’efficacité : c’est un abandon de poste. Andrésol doit partir, et céder la place à une nouvelle génération de stratèges sécuritaires.
Normil Rameau : Directeur de la PNH, Une direction policière sans impact
Lorsque Normil Rameau a été nommé à la tête de la Police nationale d’Haïti, l’espoir renaissait. Ancien inspecteur général connu pour sa rigueur, il avait la réputation d’être un professionnel intègre. Mais très vite, les attentes se sont transformées en déceptions. Les gangs ont gagné du terrain, les zones rouges se sont multipliées, et la PNH a perdu le contrôle de nombreuses zones stratégiques.
Sous sa direction, les unités d’élite comme le SWAT et l’UDMO manquent de matériels, de formation et de coordination. Les opérations sont improvisées, souvent inefficaces, et les bavures policières ont augmenté. La confiance entre la population et la police est à son plus bas niveau. Des syndicalistes policiers ont même appelé à sa démission, estimant qu’il a trahi sa mission.
L’un des exemples les plus récents de cette dérive est l’événement tragique survenu à Canapé-Vert. Deux policiers y ont été tués lors d’un affrontement avec des gangs lourdement armés. Bien que plus d’une vingtaine de bandits aient été abattus dans l’opération, cela ne suffit plus à restaurer la confiance. La police paraît en mode réactif, toujours en retard sur les gangs. Rameau n’a ni réformé la hiérarchie policière, ni établi un plan clair de réappropriation du territoire national. Il doit se retirer immédiatement.
Vers une rupture ou un effondrement total ?
Le Conseil Présidentiel de Transition a une responsabilité historique. En maintenant ces figures à des postes stratégiques, il compromet non seulement la sécurité du pays, mais également sa propre légitimité. Si des mesures fortes ne sont pas prises rapidement, le peuple les prendra pour eux. Les manifestations se multiplient, la confiance étatique s’effondre, et la communauté internationale commence à s’interroger sur la viabilité du CPT.
Il faut que des têtes tombent pour pouvoir respirer. Ces hommes doivent tirer leur révérence. Non pas dans la honte, mais dans une lucidité républicaine. Reconnaître l’échec, c’est aussi servir son pays.
Le pays a besoin d’un nouveau souffle, d’une nouvelle génération de leaders, d’un sursaut patriotique. Ce n’est qu’à cette condition que la République pourra enfin respirer.
Mais attention : si ce changement n’est pas immédiat, c’est tout le gouvernement qui partira avant l’éclatement total du Conseil Présidentiel de Transition.